Santé chiens : les vermifuges
- C’est quoi un vermifuge ?
- Quels sont les symptômes indiquant qu’un chien n’est pas vermifugé ?
- Quand faut-il vermifuger son chien ?
- Comment savoir si mon chien a des vers ?
- Le traitement vétérinaire
- Qu’en est-il des laxatifs ou des vermifuges naturels ?
C’est quoi un vermifuge ?
Un vermifuge est un traitement médical administré à nos animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, dans le but de prévenir ou de traiter les infestations de divers types de parasites intestinaux comme les ténias, les ascaris, les ankylostomes, les dirofilia et les trichures. Ces parasites et leurs larves peuvent infiltrer différents organes de l’animal, y compris le cœur, les intestins, les vaisseaux sanguins, les poumons et la peau, et peuvent entraîner des maladies potentiellement mortelles. Il est important de noter que le vermifuge est distinct d’un traitement antipuce. Chacun a sa propre fonction spécifique : l’antipuce vise à éliminer les puces, tiques, et autres insectes du pelage de l’animal, tandis que le vermifuge se concentre sur la prévention et l’éradication des parasites internes. Les vermifuges peuvent être administrés sous différentes formes, telles que des pâtes, des comprimés, des liquides ou des pipettes. Grâce à ce traitement, les parasites sont tués et expulsés du système de l’animal par les voies naturelles.
Quels sont les symptômes indiquant qu’un chien n’est pas vermifugé ?
Il est essentiel de noter que les symptômes d’une infestation parasitaire ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Cependant, il existe des symptômes d’un chien malade qui peuvent signaler une telle infestation. Ces symptômes peuvent inclure, mais ne sont pas limités à :
- Un ventre gonflé ou ballonnement : le ventre de l’animal, surtout chez les chiots, peut être dur et rond
- Vomissements et diarrhée
- Maigreur : malgré un appétit accru, certains animaux peuvent subir une perte de poids car les parasites prélèvent les nutriments essentiels de leurs intestins. Cela peut également entraîner des problèmes de coagulation et de constipation
- L’animal se frotte le derrière par terre
- Pelage terne et diminution de l’immunité
- Parasites visibles dans les selles molles
Quand faut-il vermifuger son chien ?
La fréquence à laquelle vous devez vermifuger votre chien dépend en grande partie de son âge et de son mode de vie. Les chiots devraient être vermifugés toutes les deux semaines de l’âge de 15 jours à 2 mois. Entre 2 et 6 mois, la vermifugation doit être effectuée une fois par mois. Pour les chiens adultes, la fréquence dépend de divers facteurs, y compris leur environnement. Un minimum de deux traitements par an est recommandé.
Si votre chien est souvent à l’extérieur et exposé à des risques plus élevés de contamination par des parasites, il est conseillé de le vermifuger jusqu’à quatre fois par an. Les chiens de chasse doivent également être régulièrement vermifugés, au moins 2 à 4 fois par an. Les femelles en gestation doivent être vermifugées quelques jours avant l’accouplement et deux semaines après.
Il est crucial de comprendre que l’efficacité des vermifuges n’est pas permanente. Par conséquent, il est nécessaire de répéter le traitement régulièrement. La fréquence optimale serait une fois par mois jusqu’à ce que le chien atteigne l’âge de 6 mois, puis une fois tous les trois mois pour le reste de sa vie.
Comment savoir si mon chien a des vers ?
Les chiens peuvent être contaminés par des vers de plusieurs manières. Le mode de contamination le plus fréquent est par voie orale. Par exemple, le chien peut ingérer des parasites en mangeant des excréments contaminés ou en buvant de l’eau infectée par ces parasites. Un autre mode de contamination est la voie cutanée, où les parasites pénètrent dans la peau de l’animal pour ensuite atteindre le tube digestif, surtout lorsqu’ils sont encore à l’état larvaire. D’autres voies de contamination comprennent le transfert trans-placentaire et le lait maternel pendant l’allaitement.
Au sein de l’organisme canin, deux principaux types de vers peuvent s’installer : les nématodes et les cestodes. Les nématodes sont des vers ronds ressemblant à des spaghettis, tandis que les cestodes sont des vers plats et blanchâtres. Certains cestodes, comme le ténia, peuvent atteindre une longueur impressionnante de jusqu’à 80 cm.
Un chien infesté par des vers montrera des changements de comportement. Il peut devenir agité, nerveux et même montrer des signes d’irritabilité. Si ces symptômes passent inaperçus, la situation peut s’aggraver. Dans des cas extrêmes, le chien peut même faire des crises d’épilepsie. Chez les chiots, une infestation par des vers peut retarder leur croissance. Pour les chiens adultes, des lésions graves peuvent apparaître sur certains organes, et leur système immunitaire peut être affaibli.
De manière externe, certains signes peuvent passer inaperçus si le propriétaire n’est pas suffisamment attentif, en particulier lors des phases initiales de l’infestation lorsque les symptômes sont moins visibles. Au fur et à mesure que les lésions s’aggravent, le comportement du chien peut devenir de plus en plus agressif, et d’autres signes évidents commencent à apparaître.
Des symptômes spécifiques peuvent varier en fonction du type de vers en question. Par exemple, des inflammations au niveau de la région anale peuvent survenir. Vous pouvez également remarquer que le chien se frotte l’arrière-train sur le sol, un comportement appelé le “signe du traîneau”. Pour un diagnostic précis, les vétérinaires peuvent effectuer des examens comme la coproscopie afin d’identifier les parasites et de prescrire un traitement approprié.
Le traitement vétérinaire
Tous les vermifuges ne sont pas identiques en termes d’efficacité et de cible. Par conséquent, chaque produit ne traite pas nécessairement tous les types de vers. Il est important de vérifier si le vermifuge que vous choisissez est efficace contre les nématodes (vers ronds ressemblant à des spaghettis, y compris les ascaris et les ankylostomes) et contre les cestodes (vers plats ressemblant à des rubans, incluant les dipylidiums et les échinocoques).
La forme d’administration et le dosage du vermifuge dépendent de plusieurs facteurs tels que le type de vers, l’âge de l’animal, et son poids. Il est crucial de noter que la dose pour un traitement préventif diffère de celle pour un traitement curatif. Par ailleurs, il est conseillé de vermifuger tous vos animaux domestiques, car un chien infecté peut transmettre l’infection. Consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques sur le traitement le plus approprié pour votre animal.
En général, il existe quatre types de traitements antiparasitaires :
- Les comprimés : De petite taille, ils peuvent être facilement cachés dans la nourriture du chien. Les chiens qui aiment manger les avalent généralement sans problème lorsqu’ils sont placés dans des aliments savoureux.
- Les pâtes et les liquides : Disponibles sous forme de seringue buccale ou de flacon, ces formes sont particulièrement utiles pour traiter les parasites intestinaux chez les chiots.
- Les pipettes : Ces dernières agissent sur un large spectre de vers. Elles sont pratiques car leur contenu est appliqué directement sur la peau de l’animal, généralement à la base du cou. Ce type de traitement est idéal pour les animaux difficiles à manipuler ou qui perdent l’appétit en raison de l’infestation. Prenez soin de suivre les précautions mentionnées, comme éviter que l’animal ne lèche la zone d’application et ne pas faire son toilettage le jour suivant l’administration du produit. Pensez également à vous laver les mains après l’application.
- L’injection : Bien que moins courante, cette méthode peut être utilisée lorsque l’administration orale est difficile ou en cas d’infestation sévère. Notez que certains animaux peuvent présenter des effets secondaires temporaires après une injection.
NB : La vermifugation doit idéalement être effectuée une semaine avant la vaccination pour ne pas surcharger le système immunitaire de l’animal. Un chien qui revient d’un chenil doit également être vermifugé dans la semaine suivant son retour. Si vous envisagez de voyager dans des zones à risque, comme certaines régions du sud de la France ou à l’étranger (notamment au Royaume-Uni), il est fortement recommandé de vermifuger votre animal.
Qu’en est-il des laxatifs ou des vermifuges naturels ?
Si vous observez des symptômes d’infestation par des vers, comme ceux mentionnés précédemment, vous pourriez être tenté d’utiliser des vermifuges naturels tels que l’ail pour votre chien. Cependant, il est important de noter que ces remèdes naturels, y compris les laxatifs, ont leurs limites. Un laxatif peut aider à éliminer les vers intestinaux, mais il ne cible généralement pas les parasites se trouvant dans d’autres parties du corps comme l’estomac, les poumons ou les muscles. Seul un traitement médical prescrit par un vétérinaire, tel que des comprimés antiparasitaires, est véritablement efficace contre une large gamme de parasites internes.
C’est pourquoi il est vivement recommandé de consulter un professionnel de la santé animale pour un diagnostic précis et un traitement approprié. De plus, pour alléger le coût des consultations et des traitements vétérinaires qui peuvent s’accumuler, surtout en cas de maladie grave, d’hospitalisation ou d’opération chirurgicale, il peut être sage de souscrire à une mutuelle pour animaux de compagnie. Une telle assurance permet souvent de bénéficier d’un remboursement partiel ou total des frais médicaux engagés pour le bien-être de votre animal.
- Vous aimeriez aussi
-
 Santé chiens : la maladie de Carré
Santé chiens : la maladie de Carré
-
 Santé chiens : maladies de l’appareil digestif
Santé chiens : maladies de l’appareil digestif
-
 Comment soigner une cale au coude de son chien ?
Comment soigner une cale au coude de son chien ?
-
 Santé chiens : identifier et éliminer la douleur
Santé chiens : identifier et éliminer la douleur
-
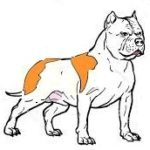 American Staffordshire terrier : la paralysie pharyngée et la polyneuropathie juvénile
American Staffordshire terrier : la paralysie pharyngée et la polyneuropathie juvénile